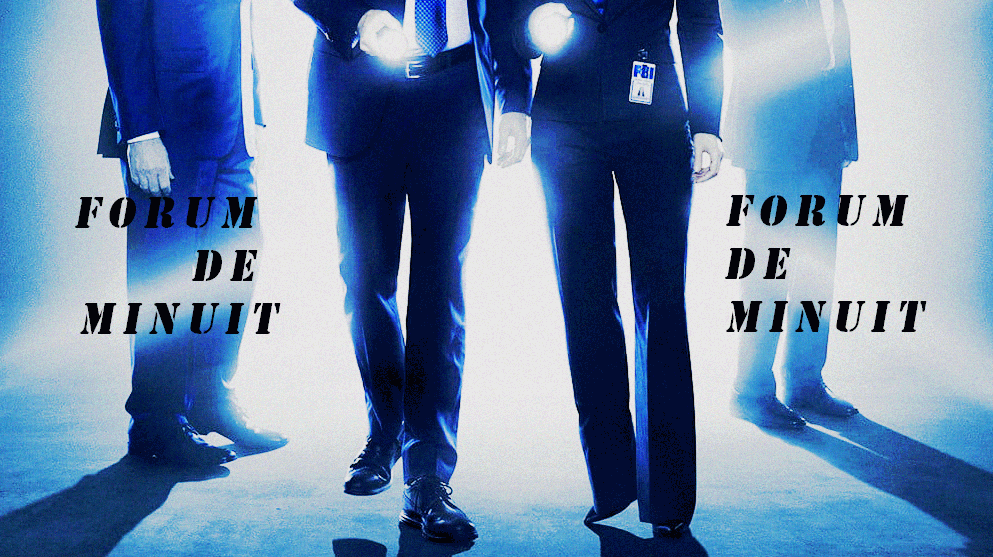[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Babaos ! Un nom qui, prononcé dans la pénombre des veillées, a fait (délicieusement ?) frissonner de peur des générations d’enfants turbulents voués aux griffes et aux crocs du monstre par des générations de parents tentant vainement de les assagir un instant.
Un nom, aujourd’hui réduit à attirer le touriste en mal de pittoresque et de manifestations folkloriques à Rivesaltes.
Un nom qui fait rêver… Un monstre surgi de nulle part. Effrayant, parce que meurtrier et insaisissable, ou parce qu’au visage trop humain sur un corps de chimère?
Et si derrière la légende il y avait autre chose ? Une porte vers un monde si proche, à nos pieds, et pourtant inaccessible ? Une porte vers un ailleurs indicible que parfois emprunte le Babaos pour venir hanter notre monde. Une porte des Enfers gardée depuis la nuit des temps par des veilleurs. Des veilleurs qui, pendant des siècles, se sont relayés, dans la tour des seigneurs de Périllos…
Les légendes des Babaos et Babau
À notre connaissance, il existe au moins deux récits, comportant de nombreuses similitudes mais aussi d’importantes différences, consacrés à la légende du Babaos. Il existe la version du Babaos de Périllos, que, par commodité, nous nommerons désormais “Version de Périllos”. Une autre version de la légende est a la faveur des Rivesaltais. Pour la distinguer de la “Version de Périllos” nous la nommerons désormais “Version de Rivesaltes”.
À première vue, mais à première vue seulement, nous sommes confrontés à deux récits racontant une histoire assez similaire mais présentant également, dans leur structure générale et leurs détails, beaucoup trop de points contradictoires et inconciliables pour que l’on puisse prendre l’une des deux versions pour un simple décalque de l’autre.
Les deux histoires semblent mettre un point d’honneur, à partir d’un même canevas de base, à broder leurs fioritures, à s’animer d’une vie propre... L’un décrit un monstre serpentiforme et ailé à visage humain, l’autre une créature amphibie ressemblant à un iguane préhistorique… L’un évoque une longue litanie de drames, l’autre des ravages qui s’étendent sur guère plus d’une semaine... L’un brosse une traque impitoyable de trois jours dans les montagnes se terminant par la chute mortelle du monstre dans un gouffre insondable, l’autre parle d’une chasse à l’affût en ville où la créature, blessée à mort, ira pitoyablement crever échouée sur les rives de l’Agly en aval de Rivesaltes…
Une localisation très précise dans le temps et l’espace
Malgré ces divergences de détail - que nous allons passer en revue et au crible par la suite – les deux récits coïncident pourtant de façon remarquable sur la datation, la localisation et le déroulement d’une partie des évènements.
La “ Version de Périllos ” précise que le Babaos a fait son apparition sur la lisière orientale des Corbières peu après le départ du seigneur de Périllos, pour la huitième et dernière croisade. En mars 1267, Louis IX est à Aigues-Mortes avant d’appareiller pour la Sardaigne et, de là, assiéger Tunis avant de succomber de la peste sous ses murs. Le seigneur de Périllos peut très bien avoir rallié l’armée du roi de France en Camargue. Ou avoir, vers 1275, rejoint Guillaume de BEAUJEU, Grand Maître de l’Ordre du Temple, et Guillaume de ROUSSILLON pour la défense désespérée de Saint Jean d’Acre. On peut donc dater les exactions du Babaos dans la période s’étendant de 1267 à 1291 (prise de Saint-Jean-d’Acre par les mamelouks).
La “ Version de Rivesaltes ” est encore plus précise puisque la première attaque du Babau est mentionnée dans la nuit du 2 au 3 février 1290 ! Précision trop remarquable pour être crédible ? Ou pour ne pas dissimuler une information capitale ? Nous y reviendrons en son temps. On remarque une confusion : en 1290, le monarque régnant sur le comté de Roussillon ne peut être Jacques II de Majorque né à Catane en 1315… mais son grand-père Jacques Ier, contemporain de son frère aîné Pierre III d’Aragon dont nous ferons plus amplement la connaissance au moment opportun. De toute façon, décrire Rivesaltes connaissant une période de paix sous leurs règnes est une douce illusion…
À notre avis, et nous nous en expliquerons longuement par la suite, il faut également prendre en considération un troisième élément de datation : l’étrange expédition solitaire du roi Pierre III d’Aragon au sommet du mont Canigou en 1285 où il rencontra un dragon surgissant de l’Etang Noir. Lac qui est la porte vers un mystérieux palais souterrain occupé par de non moins mystérieux démons…
Comme toute tragédie classique qui se respecte, la légende du Babaos répond à l’unité de temps, de lieu et d’action. Sur une période d’une vingtaine d’années, dans une région bien localisée et délimitée, un monstre nommément désigné a laissé sa trace de sang et de larmes. Et un héros, lui aussi identifié, a mis fin à ses terribles méfaits : le seigneur de Périllos et de Fraisse. Dans la “ Version de Rivesaltes ” c’est Galdric Trencavent, dont le carnaval fera un géant affublé d’une femme : Radegonda. Epouse qui, comme par hasard, porte le patronyme d’une sainte sauroctone bien connue pour avoir délivrée sa bonne ville de Poitiers de la Grande Goule et dont le nom est l’anagramme de DRAGONE !
Une approche cryptozoologique du Babaos
Avec deux énormes monstres prédateurs et contemporains, bien qu’apparemment très différents, hantant la même contrée il y a manifestement pléthore…
Plusieurs hypothèses sont alors envisageables. La plus simple, et bien sûr la plus prisée par les rationalistes, consiste à ne voir là que surenchères de Tartarins des Corbières, imagination de plumitifs locaux et tentative habile de récupérer à son profit exclusif la gloire d’avoir occis un monstre forcément imaginaire puisque les dragons n’existent pas, du moins pas plus que les météorites avant le début du XIXe siècle… Partisan de “l’évhémérisation” à outrance Jean Abélanet fait du tueur du Babaos le monstre lui-même ! Sa démonstration, si elle a le mérite d’apporter de nouveaux éléments et de clarifier bon nombre de points, a malheureusement le défaut majeur de ne rien expliquer ! On ne comprend pas pourquoi le chef d’une bande de maraudeurs pendu à Rivesaltes sur le lieu de ses crimes se transmute en héros, comment ses méfaits furent attribués à un iguane de la taille d’une baleine et ce que viennent faire dans ce bazar surréaliste quelques côtelettes géantes conservées à titre de reliques…
Tenter, dans ces conditions, de vouloir dresser un portrait-robot fiable à partir du signalement de fantômes folkloriques aussi dissemblables au premier abord relève de la gageure !
Si l’on adopte une démarche cryptozoologique, on peut admettre qu’une même créature inconnue ait été observée dans des contextes et des milieux bien spécifiques par des témoins qui, sous le coup d’une émotion bien légitime, ont retenu certains détails et, involontairement, en ont occulté d’autres. La même créature peut aussi avoir été épiée à des stades différents de sa métamorphose : si une chenille est un papillon en devenir, elle n’en présente pas moins un aspect bien différent de sa forme définitive. Il se peut également que l’on soit en présence d’un couple de créatures, présentant de grandes différences physiologiques et/ou comportementales ; le monde animal nous en montre de nombreux exemples.
D’ailleurs, à l’étude attentive du dossier, il semblerait bien que l’on se trouve en présence de plusieurs créatures similaires évoluant, sur de longues périodes, dans les Corbières, le Roussillon et la Catalogne. Créatures qui semblent être des parents d’autres “ monstres ” au signalement proche fréquentant d’autres régions du monde. On ne peut plus alors évoquer un monstre unique et donc forcément mythique, puisque sans généalogie et surgissant brusquement du néant. On est face aux représentants d’une espèce (ou de plusieurs espèces apparentées) fréquentant le même biotope dans la même région et ayant un comportement similaire et cela pendant des siècles. Même l’apparition soudaine du Babaos vers la fin du XIIIe siècle peut s’expliquer logiquement. Bien que vivant à peu de distance des humains, son monde habituel interfère rarement avec celui-ci. De plus, sa présence – ou celle de créatures très proches – est signalée dans la même région en d’autres époques. Ainsi, concernant Périllos, le religieux Marius Cornellas Naquote, dans un écrit de 1583, mentionne une créature de ce genre identifiée comme “une serpente monstrueuse et fétide issue des amours d’un ‘Draco Volans’ et d’une des fées du lieu”. Progressivement, le mythe s’estompe légèrement au profit de la zoologie.
Le portrait-robot du monstre
Les deux versions sont unanimes : on est en présence d’une créature gigantesque. Dans la “Version de Périllos”, le monstre est décrit comme un monstrueux serpent ailé à visage humain. On peut ainsi, à priori, exclure toute confusion, toute interprétation erronée à partir d’observations réelles, mais plus ou moins confuses, d’animaux parfaitement connus.
Le serpent volant aurait pu être l’observation de la chute d’un reptile grimpant aux arbres et pouvant donc en dégringoler dans ce qu’un observateur en proie à une forte émotion pourrait prendre pour un “vol plané”. Plusieurs espèces fréquentant le littoral méditerranéen peuvent faire des candidats acceptables : Elaphe longissima (couleuvre d’Esculape) ou Coluber viridiflavus (couleuvre verte et jaune). D’autres font des reptiles volants plus convaincants comme Chrysopelea ornata (serpent doré des arbres) ou Draco dussumuieri (un lézard dont les côtes forment le squelette mobile des “ailes”, déployées sous la forme de grands lobes cutanés de part et d’autres des flancs de l’animal), mais présentent l’inconvénient irrémédiable de ne fréquenter que le sud-est asiatique pour l’un et l’Inde pour l’autre…
Par sa taille qui peut avoisiner les 2 mètres (certains témoignages crédibles laissent envisager une longueur de 3 mètres) la couleuvre de Montpellier est une postulante très qualifiée à l’emploi de Babaos… Sauf qu’elle ne possède pas d’ailes, ni de visage humain et n’intègre pas bétail et bergères à son régime alimentaire…
Les trois espèces de chauve-souris hématophages connues n’ont rien de reptilien, ne présentent guère un profil d’Homo sapiens et, même si elles peuvent être de bonne taille, elles sont toutes confinées au cône sud-américain.
Le lézard commun ou même certaines variétés de grands varans ne font guère, eux non plus, des suspects très consistants.
À la vue des reliques exhibées comme provenant de la dépouille du monstre toute identification avec une espèce animale connue est impossible : la côte qui orne aujourd’hui l'office municipal du tourisme de Rivesaltes et qui fut pieusement conservée pendant bien des générations à l’église Saint André mesure 2,18 m ! Il faut se résoudre à envisager un monstre à proportion de l’os…
Ou y regarder de plus près…
En fait, il s’agit – comme d’ailleurs à Prats-de-Mollo - d’une vulgaire côte de baleine. Ainsi que l’explique Jean Abélanet, les échouages de cétacés ne sont pas exceptionnels sur les plages du Roussillon. En 1828, un baleinoptère rorqual venu finir ses jours sur le sable de Saint-Cyprien, aux côtes d’une dimension comparable à l’os présumé du Babau de Rivesaltes, offrait une longueur totale de 25,60 m et une circonférence, au niveau du thorax de 11,20 m…
Le Babau de Rivesaltes est décrit comme faisant entre 80 et 100 pams. L’empan est une ancienne unité de mesure traditionnelle basée sur la largeur de la paume d’une main humaine, et variant de 22 à 24 cm. La créature observée par les Rivesaltais avait donc une taille oscillant entre 17,60 et 24 m ! Dimension très proche de celle du rorqual précédemment cité. À titre de comparaison, rappelons que le plus grand mammifère terrestre, l’éléphant d’Afrique, mesure environ 5 m de long, entre 2 et 3,5 m de haut pour un poids moyen de 4,5 tonnes. On a ainsi une idée des dimensions colossales du Babau : un petit troupeau de pachydermes à lui tout seul !
Un Babau ou un Babaos de cette taille serait une monstrueuse impossibilité zoologique, pour ne pas dire physiologique ! Muni d’ailes en proportion d’un tel corps, le Babaos aurait dû avoir l’envergure d’un B52… Et aurait été bien incapable de faire décoller une pareille masse ! En eut-il été capable par un miracle aéronautique déjà à l’actif du hanneton (qui, si l’on en croit les lois de l’aérodynamique, ne devrait pas pouvoir voler) que l’énergie indispensable à une telle prouesse aurait été faramineuse. Et ce n’est sûrement pas en croquant bétail, marmots et bergères seulettes qu’il aurait accumulé les calories nécessaires à l’entretien d’un tel organisme. Sauf à décimer la population du Roussillon… Ce qui aurait, au moins, laissé des traces dans les archives et - surtout - la démographie locale !
Le modèle amphibie de la "Version de Rivesaltes" n’est guère plus crédible : le tirant d’eau que nécessite les évolutions aquatiques d’un tel monstre excède les dimensions de l’Agly. Une créature de la taille d’une baleine n’aurait pas pu franchir les portes de la cité, à plus forte raison une poterne ou un regard d’égout ! Une créature capable d’abattre une muraille et d’ébranler trois maisons pour ne s’emparer que d’une demi-douzaine d’enfants en bas âge SANS ETRE VU est un fantôme de Tyrannosaure obèse et passe-muraille ! En clair : une pure invention littéraire.
Souvenons-nous de quelques détails intrigants. On décrit le bouillonnement de l’onde quand le monstre remonte l’Agly, l’eau ruisselant en cascade de ses flancs, son piétinement, sa taille titanesque… Or, quelques jours auparavant, le Babau avait été d’une discrétion exemplaire jusqu’à ce qu’il se comporte en bulldozer accro à la chair des petits enfants… Personne ne l’avait vu et surtout entendu. Car, en pleine panique et par des NUITS D’HIVER SANS LUNE, être capable de donner une estimation réaliste des dimensions d’une créature inconnue en mouvement est une gageure ! Tout zoologiste vous confirmera la difficulté qu’éprouve l’immense majorité des témoins à fournir une description objective et surtout une appréciation fiable des dimensions des animaux qu’ils observent et cela même dans de bonnes conditions.
L’avocat du diable pourra toujours objecter qu’une fois mort et échoué à Ortolanes, le Babau pouvait être mesuré tout à loisir et sans risques. Encore que le récit – tartarinesque – de la découverte de son cadavre soulève quelques questions gênantes. Les monstres étaient donc si courants à l’époque dans la région qu’il faille une identification dans les règles par des témoins oculaires pour être sûr d’être en présence de la bonne dépouille ? N’était-il pas plus simple pour s’en assurer de vérifier si le monstre avait un carreau d’arbalète planté dans le gosier ?
Ne laissons pas les côtes de côté !
Mais alors que viennent faire ces côtelettes de cétacés dans une histoire de serpent volant ? Que l’échouage de baleines sur les côtes suscite émotion, interrogations et intérêt, quoi de plus naturel ? Que l’on y voit la dépouille de la baleine de Jonas, du Léviathan ou de quelques autres monstres bibliques ou mythologiques, là encore, la chose est compréhensible. Que l’on fasse de ces restes énormes les reliques démesurées de créatures antédiluviennes et qu’on les conserve pieusement dans des sanctuaires, pourquoi pas…
Sauf que…
On ne trouve pas ces reliques dans des églises du littoral où, logiquement, elles devraient être. On voit mal des gens de mer, superstitieux comme tous ceux qui vivent durement au plus près d’une Nature aussi généreuse que parfois terrifiante, ne pas conserver pour eux-mêmes ces reliques et les traditions qui s’y rattachent nécessairement.
Bizarrement, les lieux qui abritent ces étranges témoins ne possèdent aucune tradition à leur sujet, comme à Prats-de-Mollo, ou bien les attribuent, comme à Rivesaltes, aux restes d’un monstre terrestre qui n’est en rien rattaché au monde marin… Et les traditions qui rendent compte de leur existence et de leur signification les attribuent unanimement à la dépouille d’une créature ailée tuée par le seigneur de Périllos…
De quoi alors témoignent ces reliques ? Quels sont réellement leur signification, leur sens ? Nous y reviendrons longuement quand nous explorerons certains jeux de pistes dans les autres parties de notre étude.
Si, malgré l’absurdité de la chose, la tradition s’obstine à associer ces os de baleine au Babaos, c’est sûrement pour une bonne raison. Par leur taille et leur aspect, les côtes de ces cétacés peuvent rappeler fortement un aspect caractéristique du monstre, sinon elles n’auraient jamais été associées à lui. Nous verrons tout à l’heure que l’on a probablement remplacé, par suite de la disparition des véritables restes au cours des siècles (ou de leur opportune occultation), ceux-ci par d’autres offrant, par leur taille et leur aspect, une certaine similitude avec ceux du monstre. Les dimensions impressionnantes des reliques originelles n’autorisaient que peu de substituts possibles et crédibles. Il se peut que le choix d’os de baleine réponde aussi à des considérations ésotériques sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
Le portrait-robot d’un serial killer
Attachons-nous maintenant à l’étude du comportement de notre monstre. On est en présence d’un grand prédateur nocturne. Le Babaos se met en chasse dès la tombée de la nuit. Le Babau, lui, attaque toujours de nuit et il a “des yeux ronds énormes, brillants et démoniaques comme ceux d'un chat” typiques des créatures nocturnes et nyctalopes.
Il ne craint guère l’homme : il s’en nourrit même ! Peu de prédateurs mettent délibérément l’homme à leur menu ; la plupart l’évite, car ce sont eux qui finissent généralement dans son assiette ou empaillés dans son salon. Il est intelligent, rusé et prudent : malgré les efforts des autorités et les récompenses, on est incapable d’en venir à bout. Les massacres se poursuivent inexorablement pendant des années.
Comme tout bon prédateur, il applique à la lettre la loi du moindre effort et celle de la conservation de l’énergie. Il s’attaque aux proies les plus faciles : animaux domestiques, jeunes enfants ou bergères égarées.
La description de ses chasses nocturnes dans la “Version de Rivesaltes” relève du Grand Guignol ! Un monstre d’une telle taille, qui agrandit le “Forat Del Forn”, écroule des murs, fait un bruit d’enfer, au point de faire penser à un tremblement de terre, ne se contente pas de six bébés ou petits enfants en guise de trophée de chasse. C’est beaucoup d’efforts et de risques insensés pour s’offrir seulement un amuse-gueule ! Aucun prédateur digne de ce nom n’aurait un comportement aussi aberrant.
La légende enjolive les faits, abuse des effets dramatiques. Une créature nocturne s’introduisant sans bruit, sans se faire repérer dans Rivesaltes est bien plus crédible. Le Babau a dû agir comme un fauve africain qui pénètre nuitamment dans un enclos à bétail protégé par une clôture d’épineux ou dans un village ceint d’une palissade. Il s’efforce de pénétrer le plus discrètement possible dans ce vaste garde-manger tentateur et là, il s’attaque uniquement aux proies les plus petites, les plus faibles, donc les plus faciles à chasser, à tuer et à emporter… Une fois dans la place, le Babau s’attaque à des enfants, parce qu’ils offrent peu de résistance et sont d’un transport aisé… Ses activités cynégétiques dans le bourg sont fatalement bruyantes et attirent rapidement du monde. Il est alors temps pour lui, après s’être rassasié, de déguerpir le ventre plein ou de partir en transportant une proie pas trop encombrante ni lourde pour ne pas mettre sa sécurité en danger lors de sa retraite...
La chasse au Babaos
Dès son retour de croisade, le sire de Périllos se met aussitôt en chasse. “Il s’équipa de trois chiens et de trois serviteurs puis poursuivit trois jours durant l’épouvantable créature.” Pendant des années, malgré les récompenses et les efforts des autorités, on est arrivé à aucun résultat tangible. Aux grandes expéditions cynégétiques, aux battues mobilisant toute la population de la contrée, il préfère un petit commando léger et très mobile pour traquer la créature. Après des années de chasse infructueuse, en trois jours, il repère, traque et tue le monstre…
Le seigneur de Périllos se comporte en chasseur de gros gibier chevronné, sa technique de chasse s’avère redoutablement efficace. A-t-il déjà quelque expérience de la chasse au monstre ? Ou dispose-t-il aussi de quelque information précise sur la nature, les habitudes, la tanière du monstre ? Une tradition familiale, des secrets précieusement conservés par des lignées de “veilleurs”, des cénacles “d’initiés” ?
Apparemment, les ailes du Babaos ne lui permettent pas de s’enfuir… à tire d’ailes ! Peut-être même ne s’avèrent-elles utiles que pour le vol plané sur de courtes distances, de courts déplacements évoquant plus des bonds, une médiocre sustentation provisoire. À moins qu’il ne s’agisse d’excroissances, d’ailes reliques sans grande utilité, ni efficacité pour le vol… En tout cas, jamais le Babaos ne pourra semer ou même distancer ses poursuivants qui finissent par l’acculer au bord d’un précipice, nouvel indice de son peu d’aptitude aux manœuvres aéronautiques même désespérées…
L’emploi de trois chiens est également révélateur. S’ils sont efficaces pour débusquer et faire décoller une compagnie de perdreaux ou rapporter le gibier abattu, des chiens de chasse ne risquent guère d’inquiéter une créature puissamment armée et cuirassée de la taille d’une baleine, ni suivre longtemps la piste d’une créature volante. À moins bien sûr, de comprendre que le Babaos, tout en étant un redoutable prédateur de grande taille, avait des dimensions moins terrifiantes que celles que lui prêtaient complaisamment les Nemrod de courtine de Rivesaltes ; et, malgré la présence d’appendices évoquant des ailes, une rédhibitoire incapacité à voler l’obligeant à laisser au sol les traces olfactives de son passage.
"Au troisième crépuscule la bête décida d’affronter le guerrier qui dut lui décocher trois carreaux d’arme pour la blesser à mort.”
Pour venir à bout d’un prédateur aérien - si toutefois le Babaos en avait été un - l’embuscade auprès d’un appât ou de son gîte est la meilleure technique. Le tir en plein vol, surtout avec une arbalète, requiert la réunion de beaucoup plus – de beaucoup trop - de paramètres favorables : un vol en basse altitude, une bonne visibilité (guère évident avec un prédateur nocturne !), une grande dextérité dans le maniement de l’arme et une très grande expérience dans le tir sur cible mouvante (il faut tenir compte du déplacement de la cible, de possibles changements inopinés de cap, de la dérive due au vent, etc.) et énormément de chance pour loger trois carreaux d’arbalète mortels sur un Babaos poussant la complaisance jusqu’à rester à portée du tireur tout le temps nécessaire… Car l’arbalète est une arme lente : les modèles sophistiqués du XIVe siècle ne permettent que d’envoyer deux carreaux à la minute contre une douzaine de flèches pour un archer !
Le choix de cette arme par le seigneur de Périllos est un précieux indice. L’arbalète était déjà connue depuis les premières croisades, ce n’est donc pas la dernière arme secrète à la mode surgie des sables d’un Moyen-Orient toujours présenté comme la patrie des armes aussi meurtrières que mirobolantes. Un manuscrit de la Bibliothèque Nationale (Histoire du roi Artus n° 342) de la fin du Xe s montre, dans une de ses vignettes, deux arbalétriers à pied tirant contre les remparts de la ville de Tyr. Si elle est lente, en revanche, elle est excellente tant par la justesse de son tir que par sa puissance de projection. Bref, c’est l’arme idéale pour un tir en toute sécurité… Si on a pris ses précautions pour prévenir une attaque désespérée. Les trois chiens et les trois serviteurs (équipés d’épieux ?) du seigneur de Périllos devaient contenir la créature pour lui laisser le temps de décocher ses traits mortels.
Le seigneur de Fraisse et de Périllos de la “Version de Rivesaltes”, s’il privilégie la chasse à l’affût au moyen de la technique bien connue de la chèvre (ici un malheureux pourceau), utilise la même arme (probablement pour les mêmes raisons) et se tient prudemment à l’abri des remparts de la ville.
On notera d’ailleurs avec intérêt l’absence presque totale d’éléments religieux dans les deux versions de la légende : on y mentionne juste une procession – d’ailleurs annulée en raison de l’attaque nocturne du Babau ! – qui sert de repère temporel. Contrairement aux règles du genre, on n’a pas droit au monstre diabolique surgi de l’Enfer dévastant les églises, dévorant les vierges, mettant à sac la contrée et à l’épreuve la foi des chrétiens. Il n’y a pas le moindre saint, évêque, abbé, ou même moinillon pour faire fuir et mettre hors d’état de nuire le Malin incarné en monstre abominable au moyen d’eau bénite, de prières, de saintes reliques…
Il n’y a même pas de héros chevaleresque, se recommandant des saints sauroctones, se plaçant sous la protection de la sainte Eglise, invoquant la Vierge… Il n’est même pas juché sur un blanc destrier, perforant de sa lance un dragon allant faire subir les derniers outrages et une visite de son appareil digestif à une noble vierge. La récompense promise semble bien sonnante et trébuchante : on est loin de la main d’une gente damoiselle promise aux crocs du monstre.
Le seigneur de Périllos ne s’encombre pas de bénédictions, de reliques, d’actions de grâce mais d’une bonne arbalète et, soit d’une petite troupe de traqueurs, soit d’un appât alléchant et d’une bonne position de tir. C’est nettement moins édifiant et romantique, mais c’est surtout beaucoup plus réaliste. Par sa sobriété, son dépouillement grandiose, la “Version de Périllos” atteint à l’épique. Il parvient à l’essence du mythe en peu de lignes… et entre les lignes. Le factuel est dit, l’essentiel est là… À nous de décrypter.
Le mystère des trois côtes
Pourquoi revenir avec trois côtes et pas la tête ou la queue ? Si le seigneur de Périllos met trois jours pour descendre au fond de l’abîme, on imagine l’état de décomposition avancé du Babaos, déjà bien abîmé par la chute, quand il doit entreprendre la remontée avec son trophée… S’il explore l’intérieur de la terre et y découvre le cadavre du monstre, son état ne devait guère être plus engageant…
La queue ? Des édiles soupçonneux pourraient craindre une supercherie, un montage habile réalisé, par exemple, avec une énorme couleuvre de Montpellier. Et s’agit-il d’une relique suffisamment “parlante” ?
La tête ? Était-elle, après avoir dégringolée au fond du gouffre, suffisamment présentable, reconnaissable ? Ou, au contraire, n’était-elle justement par trop présentable ? Un peu trop humaine pour ne pas provoquer de malaise, d’interrogations ? La terreur vient de ce que l’on ignore… Mais aussi parfois de ce que l’on devine, l’on pressent… Le presque humain (ou l’au-delà de l’humain) n’est-il pas plus effrayant que l’animalité même poussée au paroxysme du monstrueux ? L’indicible trouble du sphinx ne provient-il pas de son torse et de sa tête de femme greffés sur une terrifiante chimère ?
Et cela sans même parler du poids de la queue ou de la tête. L’aile est bien plus caractéristique du caractère particulier, pour ne pas dire monstrueux, surnaturel de la créature. Il est vrai qu’elle est plus légère, mais aussi plus encombrante, à moins qu’on puisse la “ replier ”. Elle se conserve aussi beaucoup mieux et permet plus facilement une répartition des “reliques”.
La mention des côtes doit-elle alors se comprendre comme dans le récit de la naissance de l’Eve biblique ? Une Eve tirée, non pas d’une côte d’Adam, mais de son côté ? Les trois côtelettes du Babaos seraient alors trois éléments tirés du côté, du flanc de la créature.
Quels éléments ayant approximativement la taille d’une côte de cachalot peut-on trouver sur le côté du Babaos sinon les “doigts” gigantesques assurant l’ossature d’une aile membraneuse ressemblant à celle d’une chauve-souris ou d’un lézard volant ? Le Babaos ressemblant alors beaucoup (mis à part le visage humain) au dragon terrassé par Saint Georges peint par Paolo Uccello : un monstre au corps serpentiforme, aux puissantes pattes griffues et aux ailes membraneuses et ocellées à trois doigts…
Un gouffre ou la tanière du monstre ?
Mortellement touchée (?), la créature s’engloutit dans un gouffre si profond que trois jours furent nécessaires au sire de Périllos pour arriver à la dépouille "dont il remonta trois gigantesques côtelettes en témoignage de son combat”.
Trois jours ! Un gouffre d’une telle profondeur abyssale devrait avoir laissé des traces dans la mémoire collective et la microtoponymie locale. On peut comprendre qu’un homme prudent ait pris son temps et le maximum de précautions pour descendre dans un précipice. Mais une telle durée fait soupçonner une autre possibilité : par gouffre, il faut peut-être comprendre monde souterrain…
Grièvement blessé par les carreaux d’arbalète, le Babaos se réfugie dans le monde subterrestre dont il est originaire. Le seigneur de Périllos l’y traque alors pendant trois jours. Ou y erre tout ce temps avant de l’achever et/ou de retrouver la sortie vers le monde des hommes.
Hypothèse absurde ? Mais, s’il n’est pas une créature imaginaire, le Babaos doit bien venir de quelque lieu même s’il semble surgi de nulle part ! On peut toujours invoquer les mânes de Charles Fort et sa collection aussi extravagante qu’incontestable d’apparitions et de disparitions mystérieuses d’animaux incongrus comme les grands félins hantant le Surrey.
Avant d’envisager l’espace ou une autre dimension, scrutons la Terre…
Peu de milieux s’offrent à nos recherches : seulement la mer et la terre ferme. Rien ne rattache notre monstre à l’élément marin… Si ce n’est quelques os de baleine pieusement conservés, une créature qui semble remonter le cours d’un fleuve côtier et qui vient misérablement crever sur ses berges… La terre est bien plus prometteuse : le seigneur de Périllos n’est pas le capitaine Achab mais sa détermination est aussi farouche. Il traque le Babaos au milieu de son “théâtre d’action” habituel : les montagnes. Les gouffres insondables sont rares en plaine du Roussillon. La vicomté de Périllos est une région escarpée, sauvage et Rivesaltes n’en est guère éloignée. Comme nous le verrons abondamment dans la seconde partie de notre étude, des créatures bien proches du Babaos fréquentent, elles aussi, les zones montagneuses et se montrent aussi farouches et redoutables.
Et ces montagnes, on peut les observer des courtines du château d’Opoul. Au sud, au-delà la plaine du Roussillon, brille la couronne de neiges ceignant les hauteurs du massif du Canigou. Sur la montagne sacrée des Catalans, faisant l’objet d’un respect mêlé d’effroi des paysans, vivent des “esprits malins”, des “démons” hantant la mystérieuse Cuitat de Balaig qui se cache au fond des eaux de l’étang de même nom. La légende raconte aussi que ces murs abritent un trésor fabuleux confié à la garde d’un “terrible dragon”. Monstre qui pourrait bien être le Cerbère de service commis, par la fée Palestine, à la protection du trésor de son père le roi Elinas d’Albanie. Trésor qui ne peut être conquis de haute lutte que par un de ses descendants, rejetons presque humains de la fée Mélusine son autre fille. La belle Mélusine, mère des Lusignan qui furent rois de Chypre, d’Arménie et de JERUSALEM. Mélusine qui, tous les samedis, se transformait en une créature mi-femme et mi-serpent et qui, lorsque son secret fut révélé au monde, disparut de son château sous la forme d’un dragon ailé…
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]